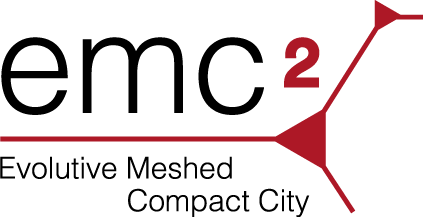Certaines rencontres ne se produisent que dans les marges d’un carnet ou autour d’un café, dans des cours imaginaires. Ici, Jane Jacobs et Christopher Alexander — cruellement absents, mais profondément présents — livrent leurs réflexions sur le projet emc2 et sa quête de la ville du quart d’heure en contexte suburbain et périurbain. Comme s’ils étaient conviés à la table, ils répondent avec les voix que nous avons appris à reconnaître : Jacobs, avec son pragmatisme instinctif forgé par la rue ; Alexander, avec sa quête silencieuse d’un tout cohérent. Les questions sont les nôtres. Les réponses… disons simplement qu’elles résonnent avec une étrange vérité.
Un moment volé, comme arraché au carnet de terrain de quelqu’un d’autre. Lara Spieck, stagiaire allemande sur le cas d’étude de Seclin (Nord) pour le projet emc2, se retrouve assise avec Jane Jacobs sur un banc discret, légèrement en retrait de ce qui fait office de rue principale à Seclin. Des camions de livraison vrombissent. Des gens promènent leur chien. Jane allume une cigarette imaginaire, observant la boulangerie du coin, d’où sort une femme avec un enfant et deux croissants.
JANE JACOBS : Bon, ce n’est pas Greenwich Village. Mais il y a quelque chose ici… de petits signes de vie qui, à leur manière, essaient de faire tenir la rue.
(Elle tapote une cendre imaginaire et jette un regard en coin.)
Alors, qu’est-ce que tu fais ici ?
LARA : Je travaille sur le cas de Seclin pour emc2, et… je me demande si on ne pousse pas trop loin l’idée de la ville du quart d’heure en l’appliquant au périurbain.
JANE JACOBS : C’est un paradoxe seulement si tu prends la ville du quart d’heure comme un plan figé, pas comme un principe. C’est vrai : le périurbain n’a pas été conçue pour la marche. Mais les gens ont toujours des besoins, des habitudes, des instincts. Ce qui est intelligent dans emc2, c’est qu’on ne tente pas de plaquer de grandes places “centre-ville” sur le périurbain.
On observe là où les gens marchent déjà, là où les services se rassemblent naturellement, et on se pose la bonne question : comment faire en sorte que ces lieux fonctionnent mieux ?
Ce n’est pas de la théorie, c’est de la bonne observation.
À Drap comme à Seclin, ils ont repéré ces voies de liaison qui fonctionnent un peu comme des rues principales d’antan. Il y a du passage. Des commerces. Des bus. Même quelques cyclistes.
Ce ne sont pas des inventions, ce sont des survivances. La vraie question, ce n’est pas comment inventer un centre à partir de rien. C’est comment reconnaître la vie déjà là, et lui donner un coup de pouce.
LARA : Mais si les urbanistes ne peuvent pas décider où s’installent les commerces, comment peut-on espérer faire advenir la ville du quart d’heure ?
JANE JACOBS : On ne peut pas — et c’est justement là le cœur du problème. Tu ne peux pas simplement zoner du “mixte” et espérer que la magie opère. Les commerces ne naissent pas parce qu’un plan les a prévus. Ils apparaissent là où la rue les appelle : là où l’on s’attarde, où l’on se voit, où l’on se sent bien.
C’est pour ça que l’attention d’emc2 aux qualités d’usage du rez-de-chaussée est si importante.
Comment est le trottoir ? Y a-t-il de l’ombre ? Des fenêtres sur la rue ? Peut-on s’asseoir, traverser, s’arrêter ?
Ce sont ces petites choses qui font qu’on gare sa voiture pour marcher. Ou mieux encore : qu’on choisit de ne pas la prendre du tout.
Emc2 ne parle pas seulement d’infrastructures. Il s’agit de comportements, et de la manière dont l’espace public les rend possibles — ou non. C’est pourquoi l’observation est cruciale.
L’équipe est sur le terrain : où les gens se regroupent-ils ? Où évitent-ils d’aller ? Et pourquoi ?
Ils n’imaginent pas une ville parfaite. Ils lisent la ville réelle.
LARA : Mais le projet couvre des études de cas en France, en Autriche, en Italie, en Suède… Est-ce que ça ne fragilise pas le modèle ?
JANE JACOBS : C’est tout le contraire : c’est ce qui le rend puissant. Une ville, ce n’est pas une machine abstraite. Elle a une histoire, une texture, des habitudes. Une petite ville de Provence, ce n’est pas une banlieue de Stockholm. Le contexte européen est fait de formes héritées : villages denses, cités d’après-guerre, patchworks de vieux et de neuf. Emc2 en tient compte.
Il ne cherche pas à tout lisser en un seul modèle. Il construit une boîte à outils adaptable.
L’idée est simple : toutes les rues n’ont pas vocation à devenir des rues principales. Mais chaque endroit a besoin d’un lieu de destination — un nœud de vie quotidienne, à portée de pas. Si on peut repérer où cette vie essaie déjà d’émerger, et qu’on l’accompagne avec de meilleurs trottoirs, du mobilier, des arbres, de la lumière — alors les gens viendront. Et resteront. Et marcheront.
Un après-midi doux à Drap (Alpes-Maritimes). Grégoire Picard, stagiaire français de l’équipe emc2, fait une pause dans son relevé des patterns de la rue. Il se retrouve plongé dans une conversation avec Christopher Alexander, qui observait les lieux depuis un moment, semble-t-il. Des oiseaux chantent sous la frondaison clairsemée devant la mairie. La place paraît un peu trop ouverte pour se sentir entière. Mais Alexander, fidèle à lui-même, commence par ce qui est déjà là.
GRÉGOIRE : Professeur Alexander, le projet emc2 cherche à adapter la ville du quart d’heure à des zones périurbaines à faible densité. Cela ne contredit-il pas votre idée d’un tout organique ?
CHRISTOPHER ALEXANDER : Ce n’est pas une contradiction. C’est une nécessité. Le périurbain est souvent perçu comme cassé ou perdu, mais en chaque lieu il existe une structure — parfois dormante, parfois morcelée — qu’on peut guérir. Ce que fait emc2 est rare : il écoute. Il ne part ni d’une géométrie, ni d’une fonction. Il part de la structure vivante. C’est cela qui importe.
À Drap, à Seclin, l’équipe a mis au jour ce que j’appellerais des proto-centres : des lieux qui jouent déjà un rôle de cœur. Ils n’ont pas l’allure de grandes places civiques, non, mais ils rassemblent des gens, des activités, de l’énergie. L’enjeu n’est pas de leur imposer une forme nouvelle. C’est de rendre visible ce qui est déjà latent. Et si on les cultive, ces lieux peuvent déployer un champ plus vaste de centres : chacun vivant, chacun relié.
GRÉGOIRE : Mais comment savoir où agir ? Le périurbain est vaste, éparpillé. Qu’est-ce qui guide la transformation ?
CHRISTOPHER ALEXANDER : Il faut commencer par produire un langage de patterns pour ces environnements suburbains : une grammaire vivante de relations récurrentes qui engendrent l’harmonie. Emc2 s’y emploie : il identifie les motifs qui donnent naissance à des rues actives, des espaces publics accueillants, des échelles humaines pour le piéton.
Comme dans notre Expérience d’Oregon, il nous faut des cartes de diagnostic. Pas des schémas, mais des cartes qui révèlent précisément où la vie cherche à se concentrer : où les croisements portent du sens, où les parcours se superposent, où la forme bâtie soutient l’interaction. Toutes les rues ne deviendront pas des centres — ce n’est pas nécessaire.
Mais chaque lieu peut trouver sa place dans un tout cohérent, si on comprend son rôle. La rue, le banc, le couvert végétal : ce ne sont pas de simples accessoires. Ce sont des actes de structure, qui permettent aux gens d’habiter leur environnement. Quand ces éléments s’accordent à l’usage et à la mémoire, ils engendrent un sentiment d’unité.
GRÉGOIRE : Et le contexte européen ? Est-ce qu’il change la manière dont le modèle fonctionne ?
CHRISTOPHER ALEXANDER : Bien sûr. La ville européenne porte une mémoire ancienne — celle de la proximité, des rythmes lents, de l’enracinement. On ne peut pas l’ignorer.
L’équipe emc2, qu’elle soit en France, en Autriche, en Italie ou en Suède, l’a bien compris.
Elle n’applique pas un modèle. Elle dégage des patterns dans les patterns, façonnés par la culture, l’histoire, la forme.
Le défi, ce n’est pas de reproduire. C’est de résonner. Dans chaque contexte, on doit se demander : qu’est-ce qui cherche à advenir ici ? Quelles relations faut-il réparer ? Quel motif attend d’émerger ?
C’est ainsi que la ville suburbaine, si longtemps traitée comme une arrière-pensée, peut redevenir un lieu de vie pleine — en rythme avec les autres, et avec la terre.